PORTRAIT DE PHILIPPE JAFFEUX EN PHILOSOPHE DE LA DÉMESURE
(À PROPOS DE PAGES, ÉD. PLAINE PAGE, COLL. CALEPINS,
JUIN 2020, 10€)
Philippe Jaffeux s’immerge de musique quand il dictaphone ses textes ; sa voix trouve inspiration, un support tout au moins, dans la texture des notes. Les PAGES qu’il nous livre aujourd’hui sont chacune d’entre elles consacrées à autant de variations critiques et impressions sonores qu’ont tantôt suscité en lui des instruments de musique (cymbalum, tabla), des genres musicaux (Boogie-Woogie, Qawwali), des compositeurs classiques (Bach, Gershwin), voire des morceaux choisis (Le Sacre du printemps, L’Anneau du Nibelung) ou des groupes (Led Zeppelin, Deep Purple) et des interprètes contemporains (Jimi Hendrix, Theolonous Monk).
Ses 52 fragments (26X2, comme un alphabet blanc prolongeant un alphabet noir : qualité de composition commune selon Jaffeux à Mozart et Miles Davis) ouvrent, grâce à leur absence de didactisme, au mystère de la musique quand elle fait perdre pied. J’ai toujours pensé que si notre poète ne marchait plus, point commun à bien des poètes, cela tenait à son système nerveux qui aurait, un beau jour, boudé la mise au pas à laquelle les appareils d’état nous plient, façon métronome. Toutes les musiques qui libèrent la parole de Philippe Jaffeux ont comme caractéristique d’échapper au cadre de la page pour atteindre au sublime à mesure que leurs lignes mélodiques transcendent la métrique.
Le philosophe allemand Hartmut Rosa dit le pouvoir émotionnel de la musique tenir d’une vitalité qui la rend « indisponible » à notre appréhension du monde tout en rendant l’auditeur plus « disponible » à son entendement (Rendre le monde disponible, La Découverte, 2020). Cet entre-deux, Philippe Jaffeux en cartographie le terrain miné : « Pacific 231 dessine l’irruption d’une locomotive dans une page subjuguée » (p. 27) puis The Who imprime « l’explosion d’un écran d’ordinateur qui retentit sur une page ébranlée par l’énergie d’un son redoutable » (p. 15).
L’explosion/irruption n’est pas ici une métaphore mais un terme d’acousticien décrivant le timbre particulier de certains phonèmes ou de certaines notes. Jaffeux se montre sensible à l’ « irruption explosive de Jerry Lee Lewis » et s’il lui appartient de faire l’histoire de ce que les cuistres appellent rupture épistémologique, plutôt que de longues dissertations, il nous invite à réécouter Le sacre du printemps pour entendre en quoi sa « rythmique endiablée rompt avec le ton policé du romantisme et de l’impressionnisme » (p. 34). Plus généralement, l’irruption explosive du Diable boiteux dans des règles bien encartées est ce à quoi Jaffeux s’est toujours intéressé· et ce qui balise (ou plutôt anti-balise) ses coups de cœur musicaux tendant tous vers « le secret d’un ‘chaordre’ » tel que (dés)orchestré dans L’apprenti sorcier après s’être partiellement dévoilé dans le « corps endiablé » de L’Air de la reine de la Nuit. De même que les anges de l’Apocalypse soufflent dans des trompettes, le Diable de Jaffeux s’accoquine in fine d’un sax pour l’ « énergie dissonante » de cet « instrument sorcier ».
Le Diable par excellence, son avatar le plus parfait, s’appelle Charlie Parker. La dissonance parvient chez ce « s xo hon st amik z » au degré d’un « amane v rtuose » exécutant « un tem o pide », si rapide que Jaffeux ne fut pas le premier à tenir Parker pour un diable d’homme. Cette appréciation appartient aussi au philosophe Dominique Pagani qui prépare depuis de longues années une Histoire de la Musique exposée de temps à autre dans des Universités populaires. Qu’un penseur marxiste ait été sensible à l’enrichissement mélodique apporté par les solos de Charlie Parker à la monotonie métrique des accords du blues pour en faire un jazz qui secoue les cadres n’a rien d’étonnant : son œil critique (ici son oreille) est exercée à l’analyse des mouvements et accélérations pour lesquels notre poète a un si grand penchant qu’il décrit Le Boléro de Ravel comme « l’accélération d’un mouvement subversif s’emparant d’une table rasée par l’intensité d’une danse bestiale » (p. 37).
L’apport historico-critique de Pagani permet non seulement de mieux cerner la musicalité telle qu’entendue par Jaffeux mais aussi de comprendre quelles sont les musiques qu’il ne peut pas entendre. D’Elvis Presley aux Rolling Stones en passant par les Beatles, Pink Floyd et Genesis compris, le rock’ en roll dans sa version pseudo sulfureuse et commerciale est le grand absent des PAGES de Jaffeux dont les goûts obéissent à un éclectisme choisi plutôt qu’à l’auberge espagnole. Il ne boude pas le punk, le scat ou le reggae mais élimine comme source d’inspiration (moteur à explosion dans son cas) toutes les mélodies que Pagani a pointé comme relevant du monde de l’hypermarché, à commencer par la battue régulière du swing telle que dirigée par un Benny Goodman, et la célébration du Capitalisme de la séduction (1981) que démythifia Michel Clouscard, secondé justement dans cet exercice par Dominique Pagani. Seul le boogie-woogie émergeait, s’émancipant du produit de marketing par la grâce de sa chorégraphie savante. « Jeu fascinant entre une mélodie et un rythme » auquel Jaffeux est si peu insensible qu’il consacre une PAGE « à la précision du boogie-woogie » dont « l’énergie du tempo démasque un monde absurde » (p. 20).
Pagani, en fin dialecticien, a très bien su mettre en corrélation la diffusion tout azimut du rock’ en roll et l’émergence simultanée, réinvention soixante-huitarde, de la musique baroque qu’il appelle à juste titre « bas rock ». Ces deux musicalités suivent un même rail, obéissent à un mot d’ordre : rendre inauthentiques des musiques authentiques, celles des Noirs dans un cas, celles des Blancs dans l’autre. Philippe Jaffeux qui se veut authentiquement noir et blanc n’accorde pas plus de PAGES au rock qu’au baroque. Ni Haydn, ni Purcell, ni Rameau, exception faite de Bach, mais Pagani soulignait déjà que la complexité des développements harmoniques de ce compositeur compensait de manière prérévolutionnaire la monotonie de la métrique de son temps. Jugement partagé par Jaffeux et qu’il exprime non pas en technicien mais en praticien de l’intérieur : « L’harmonie d’un univers musical déferle sur des mots lisibles pour éclairer la réponse d’un espace mutant » (p. 19).
Dernière caractéristique de Pagani et qui permet d’éclairer le diabolique Jaffeux : ayant dirigé le Centre de Formation et de Promotion Musicale de Niamey au Niger, son oreille y a acquis une grande sensibilité pour les polyrythmies mieux à même d’exprimer les pulsions d’une vie intérieure, or il en va de même pour ce qui fait vraiment vibrer notre poète. Les plus belles PAGES de ce dernier vont aux « solos de guembri » d’ « une nuit Gnawa », exacerbés puis sombrant « dans un silence cataleptique », ainsi qu’à la « composition psalmodique » du « rythme inspiré » des Qawwali. Et pour cause, il s’agit de deux musiques métisses qui célèbrent la liberté, l’une nourrissant de frénésie africaine le soufisme hiératique des musulmans, l’autre colorant l’harmonium des missionnaires puritains de l’exubérance indienne de la joie. (article paru dans L’INTRANQUILLE N°19, Octobre 2020)
IRAJ VALIPOUR
- Je renvoie ici le lecteur à l’une de mes précédentes études sur Philippe Jaffeux, « Bienvenue dans le Temple du Diable boiteux », Chroniques du çà et là, n°14, automne 2018.
Après la sortie de « Astéroïdes » le 6° livre de DENIS FERDINANDE à l’Atelier de l’agneau, https://atelierdelagneau.com/architextes/220-asteroides-un-carnet-de-notes-9782394280165.html voici un article inédit
DENIS FERDINANDE et l’Architexte du Chaos
par IRAJ VALIPOUR
Denis Ferdinande a commencé à écrire avec ce siècle et n’a cessé, depuis, d’écrire contre ce siècle, surtout contre l’usage fait de la langue. Siècle, il en convient, le regrette, entièrement adonné à l’action. Une action menée de plus en plus rapidement et qui donne ainsi l’impression que le monde va toujours plus vite. Impression seulement, et que génère le langage quand, gagné par l’automatisme avec lequel les actions s’enchainent, se pétrit lui-même d’automatismes. D’où la question : Cette langue toute faite qui se veut seulement descriptive d’actions que la communication généralisée tient pour l’essentiel de la production humaine ne serait-elle plus que la seule langue entendue ? Denis Ferdinande, six livres en dix-huit ans et tous publiés dans la collection « Architextes », tient, en connaisseur de la difficulté d’être édité, une réponse de sage dans son dernier volume Astéroïdes : « L’autre versant, ayant été oublié ou écarté, je veux dire poésie, ce faire indomptable et inquiétant à ce titre, s’inquiéter je m’inquiète toutefois qu’il n’ait plus de chance d’inquiéter dans l’actuel état des choses parce qu’invisible, et invisible parce qu’illisible » (p. 38).
Si le côté face de l’état contemporain de la langue est la communication et son côté pile la poésie, note doit être prise que le gros de la littérature entretient un lien étroit avec la communication. Ce bataillon s’offre des pleines vitrines chez les libraires, de plus en plus mués en communicants dont la fonction est de vendre des livres porteurs dits : « pages turners ». Ces livres déploient une action telle que le lecteur n’a de cesse de courir après les mots qui courent eux-mêmes à décrire le cours d’une action généralement débridée. La critique qui n’a plus rien de littéraire célèbre la virtuosité de ces livres (action menée avec éclat et quel brio ! quelle maestria ! quelle virtuosité !) sans bien se rendre compte que l’action va finir par s’épuiser, prise dans le vertige de sa propre vitesse, et silence s’en suivre. Tel est le constat dressé par Denis Ferdinande pour ouvrir et justifier sa dernière expérimentation poétique, Astéroïdes.
Même si, dit-il, l’art romanesque semble à son assomption, le trop plein de romans signe la mort du genre. Dès lors, le plaisir de lire ou d’écrire un roman se trouvant contrarié par le savoir si proche de sa fin, ce plaisir devient tabou et nous invite à le troquer pour un substitut plus durable. Un pari peut être lancé, il est le suivant : Sachant que l’essence mortifère du roman procède de sa course à la linéarité (un enchainement causatif où tout est établi selon des règles visant à accélérer le processus du « page turner »), le nouveau plaisir de lire ou d’écrire pourrait-il être engendré par une délinéarité, quelque chose comme un chemin des écoliers qu’aucune logique autre que la fantaisie du moment ne baliserait ? Le pari a été relevé par Denis Ferdinande, sans qu’il ne méconnaisse toutefois la difficulté de le gagner, à moins que pour le gagner il faille justement perdre (ou se perdre) ? Ce qui n’est pas exclu et qu’il n’excluait d’ailleurs pas dans le premier texte qu’il donna en 2001 : « Ne pas s’égarer sera sans doute la difficulté majeure de l’épreuve, et je ne puis d’emblée prétendre que la logique de ce qui va suivre ne sera pas celle, propre, d’un ‘de digression en digression’ mais je ne m’en excuse pas —» (« Le Cendrier-pipe », in Critères du cratère, p. 37).
Il ne s’en excuse pas parce qu’il oppose l’art de la digression à l’art romanesque, opposition de même ampleur qu’il y va entre la réalité et les faux-semblants, entre le bien-fondé et le fondé sur rien, entre le verbe créateur et l’acte narratif. Pour épuiser l’imposture de ce dernier, faire éclater l’incohérence de sa suite de fausses bonnes raisons, le dispositif expérimental de Denis Ferdinande joue sur la superposition de deux mondes. Le monde tel qu’on le connaît, le monde où la terre est toute ronde et où tout coule de source du moins grâce au romanesque qui exalte l’action, et ce monde-là Denis Ferdinande l’écrit comme tout narrateur l’écrit dans un roman qui se vend en corps 12, corps agréable à la lecture et propre à renforcer l’impression de linéarité. Et le monde tel qu’on ne le connaît pas ordinairement, le monde tel que les poètes le connaissent parce qu’ils le rêvent à mesure qu’ils l’explorent ou l’explorent à mesure qu’ils le rêvent (qui précède quoi, du rêve ou de l’exploration, les poètes ne le savent pas très bien et ne cherchent pas trop à le savoir dans leur prescience que la causalité n’est pas la maîtresse de ce monde bis), monde bis qui s’écrit en pattes de mouches comme il en va d’une note qui tombe dans ce texte narratif comme précisément une mouche dans la confiture.
Ce monde bis, c’est le monde non pas de la terre bien ronde et bien carrée à la fois mais le monde des astéroïdes puisque pour des raisons euphoniques Denis Ferdinande nous dit avoir préféré ce terme à astérisques. L’euphonie est une belle science poétique, rompant avec le train-train d’une définition collant à un mot, mais elle n’exclue pas non plus la possibilité d’entendre « astéroïdes » dans une acceptation plus terre-à-terre. « Figures astrales », nous dit Ferdinande de ces petits corps célestes qui, parce qu’ils ont des orbites plus excentriques que des planètes telles que la terre, font peser sur ces dernières des risques de collusion. La collusion, notre auteur ne s’en prive pas, tant ses apostilles astrales viennent percuter le bon sens apparent du texte en corps 12 de digressions apparemment inutiles mais qui recentrent notre vision. La linéarité de ce texte, ainsi fracturée de notes arbitraires et anti-narratives, provoque un effet de miroir et de distanciation de l’ « acte narratif réfléchi dans toute l’évidence de son inévidence » afin, prévient Ferdinande, de bien ainsi « se défendre du romanesque » (p. 8).
Si le romanesque est une grosse machine de guerre bien huilée en faveur du « page turning », la note qui vient le parasiter a pour effet de faire diversion (tel est son type de défense) mais de ce genre de diversion qu’on peut juger salutaire. Exemple : « [Note n°576] Telle digression devant laquelle il lui faut reparti, il feindra un calcul à l’œuvre quant à cette première, retombant sur ses pattes [en italiques dans le texte] au moment le plus inespéré, et critique, presque, et cela alors qu’en vérité allais-je dire, il avait oublié où il en était, une relecture est dès lors ce qui s’effectue… » (p. 40). L’oubli a ceci de créateur qu’il nous oblige à revenir toujours au même point, à savoir le point central, point fort peu négligeable mais trop souvent mis de côté quand on se disperse dans l’action. Au « page turning », Ferdinande semble préférer un « page standing » où le peu et le superfétatoire sont gratifiants par la jouissance maximum que leur qualité procure. Ainsi, après une nuit d’amour (non pas composée de banals actes sexuels mais riche de « l’assaut lyrique » du « faire l’amour une fois encore et que cette fois ne soit en rien la dernière » dans une succession digne du ballet des astéroïdes), pas de meilleur exercice rituel au gré de Ferdinande, avant de « s’en aller sombrant dans le lit », que la « lecture préalable d’un infime fragment de Livre » (p. 41) avec un L majuscule pour le distinguer des livres qu’on trouve en commerce.
Un tel Livre flirte avec le Verbe, ou le Non-Verbe, ce qui revient au même, nous allons voir pourquoi. En 2006, Denis Ferdinande s’en était porté l’écho dans son théoRire où il avait déjà exploré, entre théorie et rire, ce même procédé d’un texte pris de soubresauts aux rythmes d’astérisques alors tellement aléatoires qu’elles tombaient comme un cheveu dans la soupe puisqu’elles ne référaient à rien, ou alors à dieu sait quoi, malgré leur savante numérotation. L’effet tendait à montrer que tout était superflu hors la première phrase aussi marquante que celle de l’évangile et ainsi formulée : « Le premier mot n’est pas un mot » (p. 9). Et crac une astérisque suivie d’aucun point d’ancrage hors dans le fouillis des lignes à venir une profession de foi en faveur de l’ « instabilité conceptuelle » : bienvenue dans les zones floues du non-être (ou dans la non-zone de l’être flou), en un mot dans le « répertoire des non-genres ». Ce même classifié inclassifiable est encore présentement revendiqué par Ferdinande dans Astéroïdes dans le premier astéroïde numéroté 554 et par quoi le Livre commence comme le chaos précéda le verbe.
Un chaos qui dit « je » et poursuit par le verbe « vouloir » : « ce pari intenable, je voudrais le tenir » (p. 7), ce pari, souvenez-vous en, de renouveler l’art moribond/ mortifère du roman en le détachant de ses grosses ficelles et en le dopant à coups de notes intempestives, ce pari quasi métaphysique et aussi risqué que le coup de dé, pari qui fait dire à Ferdinande : « je lancerai ce soir la phrase, je veux dire la première, seule décisive », phrase qui se trouve justement être une simple note suspendue en l’air. Mais de cette note, ce en quoi justement elle est un astéroïde, le monde procède comme par magie sympathique. Difficile de lire Ferdinande sans qu’un écho de ce que Maïmonide disait dans Le Guide des Égarés ne revienne à l’esprit : « Tout cet univers est un seul individu vivant par le mouvement de le sphère céleste qui y occupe le même rang que tient le cœur dans ce qui a un cœur ».
Difficile, car ce corps céleste est aussi un corps lumineux qui imprègne le poète à son tour, et le poète, en tant qu’auteur de notules, de se déclarer dès lors « éclaireur parmi les éclaireurs ». Cette qualité d’enseigne, le poète la doit au fait que son vœu le plus cher serait d’être l’auteur d’un « livre chaotique », tellement il sait en lui que le chaos n’est pas ce qu’on en dit être n’a que peu voire rien à voir avec ce que les théologiens du haut de leur raison en disent : nihilisme, anarchie, que sais-je. Le chaos en est si bien l’opposé que s’il fallait donner un titre au livre auquel il présiderait, ce livre s’appellerait L’ordre des choses et serait un livre dont nul plus que Ferdinande ne « voudrait bien être l’auteur à la place de l’auteur s’il en est un » (p. 42). S’il en est un, car on ne parle pas souvent de lui. L’auteur d’ordinaire sous les feux de la rampe et à qui des cierges sont consacrés est l’auteur de ce mauvais roman de l’existence, ce démiurge dont les effets ne cessent de nous tomber dessus comme des tuiles.
On se montre beaucoup plus discret en revanche sur l’auteur du chaos, l’ Architexte en titre, celui dont le Souffle inspira le son, dont le Mot (qui n’est pas un mot – Ferdinande a raison – au sens intelligible du terme) se prolongea en une phrase déterminante pour toute la suite à venir. Chaos en grec veut dire « ouverture » et tel est le sens premier du premier mot de la bible : bereshit. Ferdinande a si bien présent à l’esprit ce parallèle qu’en plus de considérer la note comme un astéroïde, il tient son contenu pour un train à vapeur et file assez longuement cette métaphore entre la note qui éveille un monde aussi bien intérieur qu’antérieur et « le train qui repart non sans tout un tohu-bohu de mécanique ancienne en marche [1947. Cf. photograph.], avec vapeurs soudaines se mêlant aux basses nuées » (p. 52). Le tohu-bohu est l’autre nom que La Genèse (Bereshit) donne au chaos, d’après le nom de déesses araméennes qui présidaient aux nuées avant que l’esprit de raison ne vienne y planer. Pour qui veut fuir l’esprit de raison et se remettre d’accord avec l’ancien souffle, Astéroïdes peut se révéler un assez bon guide.
IRAJ VALIPOUR, auteur à l’Atelier de l’agneau de ZABOURÉ ZANE femmes postmodernes d’Iran en 150 poèmes (1963-2003) disponible sur https://atelierdelagneau.com/transfert/111-zaboure-zane-9782930440743.html
=========================================================
<>C R I tiques de livres revues et multimédias par Françoise Favretto
PHILIPPE JAFFEUX : « ARTICULONS LE GESTE D’ÉCRIRE AVEC LA ROTATION D’UN LIVRE DÉTRAQUÉ » éd Plaine page, 10 €.
Pour son nouveau livre intitulé « 26 tours »(éditions plaine page, 10 €), Philippe Jaffeux renoue avec le premier O / L’AN à savoir les vers logés dans une forme. Du O et de la forme en CD, il passe au carré mais un carré qui se déplace en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre si bien que si on feuillète le livre à toute vitesse avec le pouce, l’objet semble en effet se déplacer car basé sur tout principe cinématographique, ce qui n’est pas étranger à l’auteur par son itinéraire universitaire : il a fait des études de cinéma.
L’obsession du chiffre est la même : 26 textes donc, contenant 6 « aphorismes » chacun.
Le contenu se focalise sur la thématique du mouvement en cours. La tautologie est un moyen chez Jaffeux de surligner. Ce qui tourne dit qu’il tourne, forcément, quoi dire de plus que l’objet du sujet et le sujet de l’objet ?
Et aussi : la grammaire offre une palette de choix : les pronoms sujet changent et tournent aussi et parfois la forme impérative en « vous » ou en « nous » fait trembloter la lecture… Où suis-je dans le texte, se demande le lecteur qui tourne le livre en même temps que le locuteur joue avec lui…
Philippe Jaffeux évoque la « langue irresponsable » pour s’amuser avec les phrases. Quant aux mots, nous retrouvons le tant aimé « analphabète » qui veut définir l’auteur dès qu’il a commencé à écrire, ainsi que la valeur « hasart » avec un T. Ou « vide ». Au jeu de dés mallarméen, Jaffeux est le nouveau poète, des critiques y ont déjà fait allusion.
De plus, l’auteur se rie d’autant du lecteur qu’il propose aussi des critiques du concept de son propre livre, au cas où nous n’aurions pas d’idée, les propositions sont nombreuses. Il va même jusqu’à faire dialoguer des critiques entre eux… Car les petites phrases rythmées sont aussi des voix qui sortent de partout comme dans la pièce de théâtre publiée par Tinbad : « DEUX ».
Le côté enfantin est souligné par l’aléatoire et le ludique avec une point d’humour : « Tes lettres se limitent à être écrites par un nombre ».
Bien que l’ordinateur soit aussi responsable de cette danse, l’hommage au livre demeure :
« L’UNIVERS D UN OUTIL EN PAPIER FORGE NOTRE LUMIERE » bel hommage à ses éditeurs…Métaphore aussi du couronnement du poète…
publié le 4.05.2017
quelques articles parus dans l’Intranquille n°12 (mars 2017)
:::::::: p o é s i e ::::::::::
ROCIO DURAN-BARBA : Une voix me dit, éd. La feuille de thé, 94 p. 20 € http://www.lafeuilledethe.com
Bien que vivant à Paris, l’auteure porte son imaginaire vers son pays natal, l’Equateur. Après de nombreux livres traduits, elle écrit à présent en français, même si c’est écrire autrement dit-elle. Est-ce un livre sur la paix ?
Le volcan Cotopaxi vient de se réveiller : » sa bouche éructa d’une nuée de papillons géants. Et de pétales de neige », et les chamanes chassent la haine. En un tour d’écriture, R. Duran-Barba ficelle des poèmes construits sur le même canevas visuel, se terminant par trois adjectifs en escalier comprenant toujours le mot « étrange ». Parfois, des mots sont répétés et collés l’un à l’autre dans une police de caractère différente et produisent un réel effet qui n’a rien avoir avec une « coquetterie » d’écrivain ».
Par ailleurs, un rituel de purification a lieu. R. Duran-Bara se fait oracle, réellement inspirée à la fois par ce qu’elle narre et comment elle nous le cède, à nous lecteurs. Est-ce un livre de transe ? de passage ?
Réussissant à joindre les grandes traditions de la poésie avec une recherche textuelle, il a quelque chose d’envoûtant donnant à la lecture qu’en fit son éditrice Ghislaine Brault une « mission », celle de le publier.
:::::::::: p r o s e ::::::::::
ISABELLE POUCHIN : Les larmes amères d’Hélène, éd la feuille de thé, 20 € 120 p. novembre 2016.
Il n’est pas facile de choisir comme personnage une vieille dame coriace, toujours couchée, qui fut mère de 4 enfants et ne se contente pas d’une même gouvernante mais en a usé plusieurs à l’âge de 95 ans. On la sait athée cependant elle invoque la Vierge…bien sûr elle revient sur son enfance… Ses préoccupations de corps mal en point sont d’un réalisme assez dégoûtant ; cela fait aussi le « charme » du texte qui ne se contente pas de surface.
Et puis « les Allemands », cette période est racontée à mi-mots, il s’est passé quelque chose, mais quoi ?
Une écriture qui court et caracole, passant par-dessus la logique grammaticale, un élan de poète…à son 6ième livre, à ne pas ranger sagement dans la rubrique « poésie »…
L’auteur a publié son premier livre à l’Atelier de l’agneau : « Monet, la femme et l’enfant dans le champ de coquelicots », 2009.
:::::::: article, extrait de la revue l’INTRANQUILLE N°10 :::::::::::::::::::
13/03/2016
Poésie
Jérôme Bertin : Retour de Bâtard, éd. Al Dante 2016, 44 p. 8,50 €
L’auteur a publié 6 livres aux éditions Al Dante. Ici, des chroniques thématiques égrènent les grandes lignes d’une vie à Marseille, avec des titres qui en disent long : Boboland, Girly Girl, Dingo, Bad Boy Baby, etc. Et elles se lisent à toute allure. Les mots ne seront jamais assez forts pour donner un reflet critique sur ces textes bruts, tout à fait dans l’élan du moment, pointant souvent vers des formes poétiques instantanées et comme fulgurantes, puis se donnant au ras du quotidien le plus bas, ce que Jérôme Bertin aime, sexe et déprime, par accès. Il lit Ginsberg, il écrit, il glande, donnant de sa ville une idée aussi violente qu’un tag violet sur un mur rouge, ou l’inverse. Les personnes qu’il a choisies de portraiturer lui ressemblent : amour qui se casse, mère touchante, patronne de bar plus qu’obsessionnelle et fantasque.
Le milieu, c’est celui où il trempe, de son cul ou de sa plume, méprisant, dégueulant même sur tout ce qui représente la société, même les poètes, sauf l’ami Sylvain Courtoux.
Jérôme Bertin organise ses petits clichés avec raffinement, travaille la « chute », parfois retournante. Le lecteur pourra être partagé entre écoeurement et rires… pour ma part, j’ai beaucoup ri car l’auto-dérision y gribouille partout le non-sens d’une vie de poète. Son regard sur lui-même est d’un réalisme halluciné. Témoin du cœur battant au rythme des journées sans autre travail que d’écrire dans l’Enfer de soi-même… et de se marrer…
Volontairement, je ne donne pas de citations coupantes ou compromettantes, la surprise est dedans… Un explosif qui évite l’endormissement et qui renouvelle la poésie parce que tout simplement, il y a une tronche de poète, un corps qui se revoit, se dégrade et tente de tenir le coup, symbolique effrayante de la condition d’albatros et qui risque le pire en traversant notre décennie plombée.
Bartola Cataffi : Mars et ses ides, traduit de l’italien par Ph.Di Meo, éd. Héros Limite (Suisse) 136 p. 16 €, 2015
Le premier livre traduit de B. Cattafi (1922-1979) : L’alouette d’octobre (atelier de la feugraie) écrit dans de la même période, vers la fin de sa vie, m’avait été une grande révélation (réf : n° 8 de l’Intranquille).
Les lecteurs pourront retrouver ici ce que le traducteur nomme dans sa postface un « dynamisme cosmique », surtout dans les deux premières parties. Le poète circule parmi les éléments et un choc frontal frôle l’oxymore : « poissons de terre » « corps contondant » Le paysage et le corps se retrouvent mixés sans jamais se mélanger. Cataffi a l’art de restructurer comme un chirurgien esthétique du paysage et du corps. Il provoque des greffes étranges. « Surtout d’autres yeux et oreilles / à implanter / tournants dans la belle / dans la mauvaise saison. »
Au cours des deux autres parties, les phrases se présentent moins cassées, plus fluides, grâce à la répétition des saisons comme l’appel de Mars mais aussi le désespoir de la viellesse. Cattafi a beaucoup voyagé, laissant des poèmes souvent empreints de lieux marins et d’une certaine conscience voyageuse : « être en fuite ».
Bien qu’une certaine nostalgie exsude de quelques vers, Cattafi ne fait pas dans l’émotionnel : « la sensation du sec et du coupant » pourrait s’appliquer à son univers tout plein d’un lexique qu’on trouve peu en poésie : pliable, molécule, oligocène, etc.
Ismaël Savadogo : Le sable de la terre, éd. Le Lavoir St-Martin, 40 p. 10 €. nov. 2015
Poèmes crépusculaires comme la couverture du livre (« croix dans la solitude » de T.Cole). On ne s’attend pas à ce qu’un auteur ivoirien de 34 ans publie un premier livre qui porte ainsi la marque d’une recherche parmi les morts. Lente descente vers l’obscur qui nous entretient en même temps du travail du poème. (« J’écris seulement des phrases sorties d’une nuit noire et difficile » ) Et une remontée vers les anges, les étoiles. « La consolation de l’infini » aurait pu en être le titre.
Rêves, mesure du temps, absence de mémoire : ces thématiques courent à travers les textes écrits avec application voire raffinement, disant l’incertitude. Ou bien concluant : « Tout n’est que le même ».
Maîtrise du verbe, flottement du thème : « Et se maintenir ainsi sur une possibilité de suspension ».
roman
Lucie Taïeb : SAFE, éd. de l’Ogre, 170 p. 18 €. Janvier 2016
« Certaines choses avaient été prévues ». Voilà la narratrice et ses personnages livrés à un monde prédestiné dont ils n’ont pas la clé et pas la peine pour le lecteur de la chercher. Tout le monde erre dans un univers onirique où passent et repassent des êtres bien « typés » : la mère d’abord qui a empêché sa fille de voir vraiment ce que sont les hommes si bien qu’elle entre comme une poule mouillée dans l’âge adulte, pourtant encore SAFE : « Arrivée à la majorité, en excellent état, n’ayant presque jamais servi, j’étais sauve ». Mère qu’à la fin elle voudrait morte. Puis celui à qui est adressé le « Tu » qui court tout au long du texte, son compagnon sans doute, dormant à côté d’elle. Ensuite apparaît Aloïs, sorte d’enfant ou du moins adulte naïf. Et des amies, des individus flous et peu indentifiables.
Le monde décrit est encombré, menaçant. L’atmosphère, pesante. Les humains plutôt endormis, tout ceci enrobé dans le thème récurrent des apparitions/disparitions, fuites et retours. Et traversé par des maux divers : crash d’avion, maladies – surtout la siphyllis – épidémies, tendance aux suicides, folie qui conduit à enfermement.
La traduction tenant une bonne part du jeu, surtout au début (un rébus ?), il s’agit de traduire « safe », qu’on retrouve codé en « SaFe » (qui signifierait sage-femme dans la logique du livre).
À peine de science-fiction, plutôt kafkaïen, ce livre est appelé « roman » par l’éditeur. En tout cas pour nous, une prose poétique entraînante et noire, qui met mal à l’aise et chevauche un demi-cheval : celui de rêve ou celui de l’écriture.
REVUE
NU(e) N° 58 septembre 2015. 210 p. 20 € au 29 avenue Primerose 06000 NICE
Cette livraison coordonnée par Philippe Di Meo se consacre entièrement à ANDREA ZANZOTTO, poète italien dont 9 livres ont été traduits en français. (Nous avions publié des haïkus dans le n° 7 de l’Intranquille dossier « poètes italiens »)
La plupart des poèmes de ZANZOTTO révèlent, comme le montrent les premières pages, un travail visuel raffiné, petits dessins, glissement des lignes, trous et formes. Il explique dans l’un des trois entretiens publiés, qu’il admire plus que tout la poésie gréco-alexandrine qui se présente en formes d’amphores ou de vases…
Douze études nous montrent les contours de cette poésie, dite cosmique comme celle de Cattafi, d’ailleurs… Ph.DI Meo traduit les deux… Le tout précédé de 3 entretiens avec l’auteur qui fut aussi critique.
Tentatives de définition de l’indéfinie poésie, réponses aux remarques sur les difficultés de lire la poésie contemporaine.
Sommaire des critiques précédentes :
Poésie — Olivier Massé : Tanka du café
ESSAI — Aurélie Le Née : La poésie de F.Mayröcker
Poésie— livres de Jean-René Lassalle, Frédéric Musso
POÉSIE —26/08/2014—
Olivier Massé : Tanka du café, éd du tanka francophone. 46 p. – 15$ http://www.revue-tanka-francophone.com Ces éditions se trouvent au Québec et ne publient que la forme poétique du tanka. Ce livre est le 21ième de la maison d’édition. Le poète bordelais Olivier Massé a publié deux livres.
Perdu dans ses pensées, et même souffrant de quelque douleur inconnue, il est d’abord solitaire entre tous… et regarde le monde autour : quelqu’un lit, quelqu’un nettoie, d’autres téléphonent :
« en face de moi
il insiste au téléphone
a-t-il sur moi l’avantage
il sait qui doit arriver »
On pourrait appeler le texte « café-nostalgie » car le poète est obsédé par un visage dont le lecteur ne saura rien…
Il prend un café dans un lieu familier ou auprès d’un distributeur mais ce non-héros n’aime pas vraiment cette boisson, il n’en fait pas l’éloge, d’ailleurs, le mot « brûle » revient plusieurs fois…c’est plutôt une occasion d’écrire, (le « je » lyrique s’impose) se situer par rapport aux autres, le patron, les serveurs – et surtout une femme qui fait l’objet d’une série entière de poèmes —, les clients, les passants :
« Derrière la vitre
devant la table où je reste
les piétons défilent
mes deux yeux les accompagnent
sans pouvoir suivre personne »
ou du monde du travail quand il est au distributeur :
« trouverons-nous mieux ensemble
enfin la satisfaction »
Observant sa tasse, il y lit son passé mais surtout quand il n’est plus au café, l’effet « madeleine » marche bien :
« Sur mes lèvres sèches
seul au vent depuis des heures
je passe la langue
avec le goût du café
revient l’image oubliée »
Fin observateur, on ne peut lui reprocher de faire une poésie de comptoir…
Il offre au lecteur des métaphores puissantes comme celle des gobelets dans une poubelle comparés à un tas d’ossements. Ou ce mystère :
« dans mon livre mal fermé
vit un messager ailé »
Facile à lire, et on n’en décroche pas. Même si l’image du poète est convenue : solitaire et souffrant, ça se noie dans le café…
ESSAI
Aurélie LE NEE : La poésie de Friederike Mayröcker – une « œuvre ouverte », éd.Peter Lang, 453 p., 99 € www.peterlang.com
Sous-titrée « essai d’introduction », voici la première somme en français portant sur F.MAYROCKER à laquelle Aurélie Le Née a consacré sa thèse. Le corpus n’intègre pas les œuvres publiées après 2003.
Le sujet étudié par A.Le Née portait sur les couples opposés et le dialogue : même si le travail de F.M. a frôlé les expériences limites de la langue, on y apprend quand même que pour l’auteure viennoise, il n’y a pas d’écriture sans inspiration et que sa façon de travailler est une « roue en feu », non loin du St-Esprit. L’avancée pas à pas, semée de poèmes, de ce dédale de contrastes et véritablement passionnant, et je continue…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
LOROGLOSSE TORSADÉE
Jean-René LASSALLE : Poèmes carrés, poésie, 130 p. 14 €, éditions Grèges, Montpellier, 2012.
L’auteur les salue à la fin, ces poètes qui ont écrit avant lui des textes justifiés en carrés.
Les siens sont, de plus, inclus dans un dessin de carré, clôture. La contrainte réside – et ça en est la conséquence, en 18 vers pour chacun dans cette « maison de cubes aérés » (sic) qu’est ce livre dont l’écriture expérimentale, comme on peut s’y attendre, demande au lecteur une attention forte. Il s’en dégage assez vite des jeux avec les mots et des contournements de toutes formes convenues.
La technique inconsciente du glissement vers d’autres langues : l’allemand qu’il enseigne et traduit, l’anglais, l’italien, l’espagnol et autres (inventées ?) n’est encore rien en regard des créations de syntagmes. Le mot en effet est au cœur du travail de LASSALLE car la ponctuation, souvent absente ou faite de points, assomme d’emblée la syntaxe sans autre forme de procès. Bled et Grévisse deviendraient fous, les profs de français prendraient des sueurs froides…
Le néologisme chez Lassalle mériterait une étude spécifique et approfondie. Poétique par le choc des images qu’il provoque chez le lecteur, j’en donne quelques-uns : mémore,
cœurviande, hyperperlée ; dulcaquicole, branchiophalle, interlockés, sorleil, nèverose, exosquelette, rejaillipresse…
Il excelle avec la création de mots composés : boue-tabac, blattling-skelett, femmes-abeilles, seau-tare, mythe-Himalaya, corps-non-clone, auto-le-soi, suce-corne. Parfois, ça frôle la comptine : « luge-neige, givre-neige ; ça rallonge : dire-mille-ne-change-mais-si-mille-dire ; et, bégayant : « bi-bilan, la-l’attente » Quant aux voyelles finales redoublées : souvent des « i » qui crient…
Mise à mal de la grammaire aussi : perturbations des personnes et usage de la faute qui fait perdre 4 points aux dictées…cherchez l’erreur :« tu t’appelle elle et je m’appelle toi » et des genres : « son grisaille, son lave, mercie de ». Non, ici le critique ne peut faire de coquilles…
L’expression, ou la phase, pour autant qu’elle subsiste, peut produire des effets très poétiques : « poignardé d’amanites », « en costume d’ours, aille vers le bois d’abeille » (pour ce dernier mot, le singulier arrive comme une cerise sur le gâteau carré…), « la guerre mondiale de 30 ans » , « hé la fourmi merci de donner ton image d’air chaud à enlacer » (que j’aime particulièrement).
Et la surprise du slogan au milieu de séries de mots et d’associations inventives et niant toute tentative de compréhension directe : « aime ton dealer, ton corps t’aimera »
« un avion inquiète plus qu’un moustique »
« et est humain qui aide à sublimer violence ».
Très satisfaisante pour le lecteur, l’image doublée d’un néologisme, »elle presse tes tétons de chancelin », le sens du référent reste à imaginer !
Parmi les jeux, un trou BLANC carré au milieu d’un des textes ; un autre, comme une stèle antique, est « gravé » en majuscules avec des V à la place des U et des points pour les espaces. Des anagrammes en mots croisés à partir du mot SITAR. Effets visuels aussi de lettres des polices de caractères différentes dans le même poème. Indices fantaisistes pour notes en bas de pages qui n’existent pas. Un poème parsemé de cris sans blancs « Whiiiii »
Le secret de chaque livre se cache souvent dedans. Pour celui-ci, le voici à la page 38 : « Parlant loroglosse torsadée ». Quand le lecteur trouve dans la torsade où il est lui-même enroulé, ce moment de repos lucide où il saisit, cela sonne comme une déclaration.
Hors la tentative intellectuelle de Lassalle, qui d’ailleurs ne manque pas d’humour, l’invention poétique est à son comble ici :
« ciel matin vert où chahutent mie de nuages à manger »
« bruit de pas de l’enfant qui court vers qui le pense ».
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Frédéric MUSSO : L’exil et sa demeure, poésie, 96 p. 14 €, mars 2013, Éditions de La Table Ronde .
Quels paysages, pour les ambiances ? il y en a deux, le bord de mer et la nuit.
Quels univers ? celui des rêves : « consumés dans la broderie du sommeil » et celui de l’enfance (« Vider la mer avec son seau »).
L’auteur place les premiers plans, souvent des photographies très « zoomées », une vue acérée du printemps – masque d’une pensée, lame d’une feuille -, la recherche d’une pierre à deux veines croisées ; et des touches sonores. Détails de bruits auxquels personne ne ferait attention : les tapotements des doigts d’une femmes sur un comptoir, un rideau qui se baisse…
A part les femmes, ses personnages sont les poètes ; il dit, en poète lui-même, se préoccuper de la métaphore…
Quel point de vue original sur les trajectoires ! ça tourne à la distorsion avec des métaphores justement : « plier les deux moitiés de l’été par une diagonale » ; « quand tu atteins le fond de l’univers, donne un cou de pied pour remonter »
Ajoutez à cela quelques parcelles d’un érotisme bienvenu, le tout présenté en poèmes de 5 ou six lignes, justifiés comme la prose et vous aurez une idée du projet de Frédéric Musso : « reconstruire le bateau de Thésée »… pour quel voyage ? Voile noire, voile blanche, croisées et ratages que la poésie ne manque pas de métaphoriser…
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

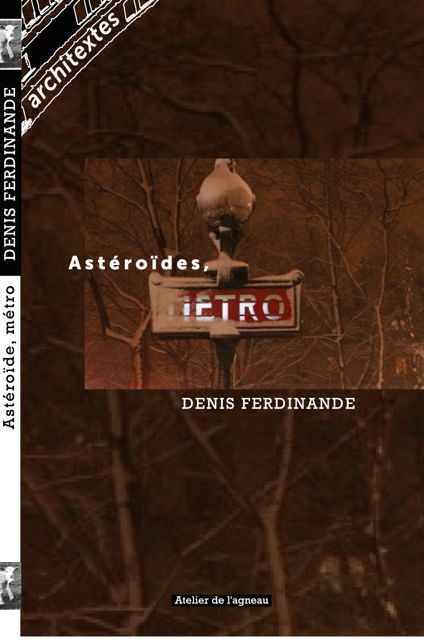
Je viens de lire votre fine critique et je vous en remercie.
Frédéric Musso